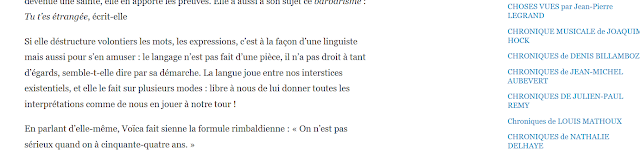Quand tu as 20 exemplaires de ton livre (Les nuages caressent la terre) à envoyer pour le service de presse et quand tu "évites", comme d'habitude (!) les (trop) grands et les (trop) petits, et quand, cinq mois après la publication, tu as encore quatre exemplaires à envoyer, et tu ne sais pas à qui !
Entre temps, tu as aussi envoyé (sans grande conviction) à Eric Allard (Belgique).
Et en recevant ton livre, il te "raconte" un peu sa vie, dont tu ignorais tout (entre autres, marié à une... roumaine, il va régulièrement en Roumanie).
Mais, en le lui envoyant,
tout en sachant qu'il lit beaucoup et... bien !
Et voilà - quatre mois après ton envoi - sa note de lecture est publiée, en confirmant ta "confiance" !
Tu es extrêmement touchée, surtout qu'il n'a pas lu/commenté seulement le livre envoyé, mais aussi tes deux autres, en les reliant d'une manière... cohérente !
Ses propos, plutôt succinctes, sont tellement justes !
Et donc émouvants !
Son texte autrement :
Les nuages caressent la terre de Sanda Voïca, paru cette année aux éditions Les Lieux-Dits, comporte cinq parties, composées chacune de textes et poèmes écrits suite au décès, en 2015, de sa fille Clara, à l’âge de 22 ans et qui, tous, sont marqués par cette perte. Chaque section est accompagnée de deux ou trois oeuvres d’artistes différents qui allient la gravité à l’apparente sobriété, et qui constituent des soutiens aux textes, dans les deux sens du terme.
Dans Trajectoire déroutée, paru aux Editions Lanskine, Sanda Voïca, proposait une septantaine de poèmes dans une forme plus classique, beaux et touchants ; elle y parlait de Clara en la nommant « la fille disparue » ou « la fille » sans s’autoriser, sauf une fois, le possessif « ma ».
À la toute fin du précédent recueil, elle écrivait « Me voilà », comme si malgré la douleur elle avait sur-vécu. Dans la première section de ce nouveau recueil, elle écrit : « Sanda Voïca / est de retour / […] Jamais je ne l’aurais cru. ». Si dans le précédent recueil, la poète maintenait comme une distance avec le drame, ici, surtout dans la première partie intitulée Paysange, un mot valise pour dire un paysage mental investi par la figure de Clara sa fille, elle questionne dans chaque texte la présence/absence, à la façon d’un Journal d’après et d’une manière qui m’a rappelé son déjà prenant recueil Epopopèmémés (composé de 27 poèmes écrits entre le 28 novembre 2011 au 15 mars 2012) sorti chez Impeccables dans lequel livre les faits du quotidien étaient passés au crible la vigueur de l’intellect de la poétesse.
Dans Les nuages caressent la terre, Voïca inclut la disparition à ce que sont devenu ses jours, cherchant, une possibilité de vivre en accord avec ce qui est arrivé, ainsi qu’à formuler l’inexprimable. C’est cette quête d’un sens, d’une formulation, ce souci du questionnement perpétuel, d’approcher toujours plus près une manière de vivre encore en sachant qu’aucune vérité n’existe et que le travail de deuil ne cessera pas, qui fait tout le prix de ces textes. Des textes qui nous absorbent et qu’elle nous fait ressentir en tant que « lecteur-regardeur » invité au partage de ses mots.
Comme dans le si singulier Epopopoèmémés, Voïca incorpore à son propos ses chocs littéraires ou artistiques, elle y assimile aussi bien le journalier dans sa crudité qu’elle n’y fait état d’une tentation à la sainteté – déjà présente avant le drame personnel.
Ainsi, pour ne citer qu’un exemple, « en vidant la corbeille, / en fermant le sachet-poubelle », elle fait le constat que « le plein est enfin le vide ». Á la fois dissociée par la perte et comme augmentée de l’âme de son enfant, elle se vit séparée et double. Clara est devenue une sainte, elle en apporte les preuves. Elle a aussi à son sujet ce barbarisme : Tu t’es étrangée, écrit-elle
Si elle déstructure volontiers les mots, les expressions, c’est à la façon d’une linguiste mais aussi pour s’en amuser : le langage n’est pas fait d’une pièce, il n’a pas droit à tant d’égards, semble-t-elle dire par sa démarche. La langue joue entre nos interstices existentiels, et elle le fait sur plusieurs modes : libre à nous de lui donner toutes les interprétations comme de nous en jouer à notre tour !
En parlant d’elle-même, Voïca fait sienne la formule rimbaldienne : « On n’est pas sérieux quand on à cinquante-quatre ans. »

Plus gravement, elle écrit qu’elle ne peut plus rêver « parce que [elle n’est] plus connectée ». Elle parle de la « grâce douloureuse de chaque instant », de « cet écartèlement qui n’arrêtera jamais », de la couleur rouge, celle du feu, du sang, qui brûle en elle comme il a brûlé dans le ventre de sa fille.
« Jusqu’où une âme peut perdre ?
La mienne pourra-t-elle gagner parfois ? »
Le plus difficile à vivre, observe-t-elle, est l’absence de certitude sur le fait de savoir si l’âme de son enfant est là ou non, et de quelle âme s’agit-il ? Malgré la douleur, la lucidité demeure, l’inépuisable questionnement sur l’existence de l’âme.
Son rapport au réel est rompu ou, du moins, métamorphosé.
« Ma petite fille qui es aux cieux
Ou ailleurs
Ou plus du tout
Donne-moi la force de te dire
Ce que je ne te dirai jamais.
[…]
Et de me laisser avec mon seul grand moment
Qu’est devenue ma vie sans toi.*
Ella fait aussi ce constat, terrible, mais qui ne peut avoir lieu qu’une fois lorsqu’une vie est achevée ou, plus précisément, interrompue par la maladie.
« Te voilà enfin d’un bloc –
De la naissance jusqu’à la fin :
Tout faite, entièrement faite,
Il n’y a plus rien à rajouter, »
On le devine à ces quelques extraits : on ne sort pas indemne de la lecture des textes de Sanda Voïca.
Des couleurs en profondeur, Ecrits dans l’air, Vibre le vent, Raison sans raison,
aux titres explicites, poursuivent, sous d’autres formes et en des
poèmes plus courts, moins autocentrés de prime abord, cette poétique de
la présence/absence au monde où le dehors et le dedans, le ciel et la
terre, les os et la chair, la neige et le feu, signifié et signifiant,
les mots et la mort sont sinon remis en cause mis en liaison via les
nuages, les nerfs, tout ce qui distingue l’écriture-miroir ultrasensible
de Sanda Voïca.
Le ciel, mon miroir,
Les mots, mon ciel.
L’écritoire – ma terre.
Sanda Voïca, Les nuages caressent la terre, Les parallèles croisées — Les Lieux-Dits, Strasbourg, 2022, 96 p., 18 €.
Avec le texte de 4ème de couverture de Germain Roesz et les créations de : Véronique Sablery, Philippe Boutibonnes, Liviu Şoptelea, Danièle Massu-Marie, Sylvie Durbec, Clara Pop-Dudouit, Ghislaine Lejard, Maurice Marie, Jean-Pierre Stevens, Caroline François-Rubino, Samuel Dudouit, Sanda Voïca.